Le monde d'hier, souvenirs d'un Européen ; Stefan Zweig
 Le Livre de Poche ; 506 pages.
Le Livre de Poche ; 506 pages.
Traduit par Serge Niémetz.
1944.
C'est durant ses années d'exil, à partir de 1934, que Stefan Zweig entreprend l'écriture d'un livre où il évoque, à l'aide de sa seule mémoire, les événements de sa vie, depuis la Vienne de son enfance à "l'agonie de la paix" européenne. Ce n'est pas vraiment le récit de sa vie, mais plutôt le portrait d'un monde qu'il aimerait retenir, avec toutes ses figures marquantes. En vain.
"entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts sont rompus."
Ainsi, nous débutons dans une capitale autrichienne somptueuse, qui n'a d'amour que pour l'art, et qui a une vision positiviste du monde."Tout, dans notre monarchie autrichienne, presque millénaire, semblait fondé sur la durée, et l'Etat lui-même semblait garant de cette pérennité." Vienne n'est plus un centre politique européen de premier plan pour Zweig, qui y voit une opportunité pour la ville de prendre un rythme lent. Les informations sur les guerres et les révolutions semblent lointaines, la précipitation de la jeunesse est refoulée, les bonnes moeurs et l'hypocrisie qui les entoure sont prêchées. Zweig s'ennuie à l'école, mais ses camarades et lui sont assoiffés de connaissances, et se rendent à l'université, dans les librairies, dans les cafés, partout où l'on peut obtenir des informations. Ils vénèrent les nouveaux génies, et essaient d'avoir toujours d'avoir les bonnes intuitions en ce qui concerne les futurs grands artistes.
Une fois à l'université, Zweig s'inscrit en philosophie, puis part à travers l'Europe. Il se lie ainsi d'amitié avec de nombreuses grandes figures des arts de l'époque. Romain Rolland, Emile Verhaeren et d'autres deviennent ses amis intimes. Il voyage sans passeport, dans un monde qui n'éprouve pas de suspicion face aux touristes étrangers. Il se sent européen avant tout. "Nous poussâmes des cris d'allégresse, à Vienne, quand Blériot franchit la Manche, comme s'il était un héros de notre patrie. Grâce à la fierté qu'inspiraient à chaque heure les triomphes sans cesse renouvelés de notre technique, de notre science, pour la première fois, un sentiment de solidarité européenne, une conscience nationale européenne, était en devenir." Ses écrits trouvent très tôt un très bon éditeur et un public enthousiaste.
Mais ce monde à qui tout était promis se retrouve dans une obscurité paradoxale. "Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture qu'une mince couche que peuvent crever à chaque instant les forces destructrices du monde souterrain..." Les progrès techniques n'y ont rien fait non plus, bien au contraire."Nulle part je ne puis me procurer de renseignements, car dans le monde entier les relations postales de pays à pays sont rompues ou entravées par la censure. Nous vivons aussi isolés les uns des autres qu'il y a des centaines d'années, alors que l'on n'avait inventé ni les bateaux à vapeur, ni les chemins de fer, ni l'avion, ni la poste. " La course aux armements débute. Après l'attentat de Sarajevo, la Première Guerre mondiale est déclenchée. Zweig est horrifié, mais il croit encore que le monde n'est pas perdu. Malgré le Traité de Versailles et l'humiliation de l'Allemagne, il tente de participer à l'esprit de Genève et d'oeuvrer pour la paix.
Ses espoirs fondent, bien entendu. Avec la montée d'Hitler, il voit des amis le rejeter, l'Autriche lui semble de moins en moins être sa patrie. Ses voyages en Italie et en Russie ne lui font que trop bien comprendre ce quelles sont les menaces que présente le nazisme. Avec tant d'autres, il est censuré, parce que juif. La guerre n'est plus ressentie comme honteuse, et bientôt Zweig n'a plus que la fuite comme solution. Il se rend d'abord à Londres, apatride et sans illusions, puis en Amérique du Sud.
Il ne verra jamais la fin de la guerre, puisque c'est au Brésil qu'il se donne la mort au début de l'année 1942.
Cela fait déjà une quinzaine de jours que j'ai terminé ce livre, et quelques reproches subsistent. J'ai adoré rencontrer les gens dont parle Zweig, le suivre dans son parcours. Son livre est très riche, et donne une envie irrépressible d'en savoir plus sur l'Europe Centrale.
D'un autre côté, j'ai du mal à être totalement enthousiaste. Zweig manque manifestement de recul. Il est désespéré quand il écrit son livre (ce qui est tout à fait compréhensible), mais de ce fait, j'avais aussi l'impression d'être plongée dans un monde qui mélange le vrai et le faux, et qui occulte totalement l'existence du second degré. Je vais essayer de le formuler sans être blessante, mais le personnage même de Zweig n'est pas toujours très sympathique. Il fait gosse de riches pleurnichard* à diverses reprises, ses observations sont parfois naïves, sans doute à cause de son origine sociale, et malgré ses protestations de modestie, on sent qu'il ne se prend pas pour n'importe qui. Il dit dans sa préface avoir une confiance absolue en la mémoire pour faire le tri de façon logique et intelligente, je ne suis pas de son avis.
D'une façon globale, j'ai toujours détesté les livres-témoignages. Je trouve qu'ils transforment presque inévitablement une image négative de leur auteur, alors même que les sujets dont ils parlent sont censés provoquer la sympathie du lecteur (je ne citerai pas de titre, mais je pense notamment à un livre qui a ému toute la France il y a quelques années, et dont j'ai trouvé l'auteur absolument infect). Toutefois, Le Monde d'hier est bien meilleur, puisqu'il ne s'agit pas d'un simple livre "ma vie, mon oeuvre, mon drame". Et le Zweig qui transparaît n'est qu'un Zweig à un instant donné, mais en tant que personnage de livre, je n'avais pas toujours envie de m'y intéresser.
Un livre très intéressant, mais pour lequel j'éprouve quelques réserves malgré tout.
Livre lu dans le cadre du challenge Ich Liebe Zweig de Caro[line] et Karine.

Les avis de Caro[line], Karine et Nanne, qui ont aimé sans réserve.
*Ok, pour la gentillesse, on repassera...







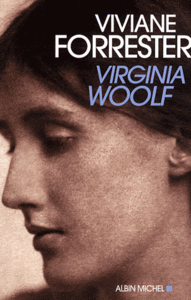



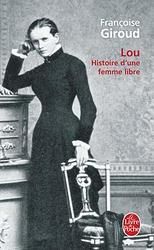


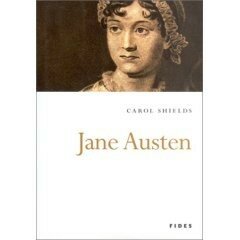
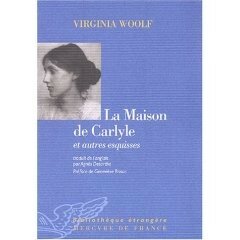


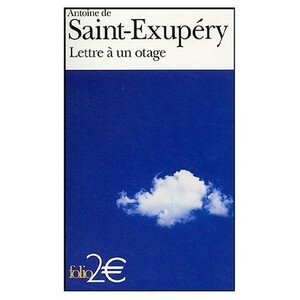
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F5%2F157686.jpg)