Les Années ; Virginia Woolf
 Folio ; 572 pages.
Folio ; 572 pages.
Traduit par Germaine Delamain et Colette-Marie Huet. Préface de Christine Jordis.
V.O. : The Years. 1937.
Il est très difficile de parler des romans d'un auteur que l'on aime comme j'aime Virginia Woolf. Dans ces cas là, l'objectivité est encore plus éloignée, et il ne s'agit plus seulement de parler d'un texte, mais d'une relation (je suis très sentimentale, mais si vous saviez tout ce que je dois à Virginia Woolf...).
Je me suis plongée dans Les Années parce qu'après Céline, je savais qu'il serait difficile de ne pas trouver mes lectures fades. J'ai eu mille fois raison, ce livre est un immense roman.
Que s'y passe t-il ? Tout et rien en même temps. Nous suivons une famille anglaise, les Pargiter, depuis 1880 jusqu'aux années 1930, mais il ne s'agit aucunement d'une saga familiale.
Les personnages sont attachants, deviennent familiers. J'ai bien sûr complètement fondu devant Edward, cet homme assommant d'érudition, mais aussi d'une grande beauté et surtout au coeur irrémédiablement brisé, un être "dont l'intérieur a été dévoré, ne laissant que les ailes et la carapace". Les événements politiques et sociaux apparaissent en toile de fond, rythment le récit, et ce pied dans la réalité nous permet de voir l'évolution extérieure des choses et des hommes.
Toutefois, si je dit qu'il n'est pas non plus faux d'affirmer qu'il ne se passe rien, c'est parce que le lecteur à la recherche d'une intrigue suivie et palpitante de manière traditionnelle sera nécessairement frustré. Il y a beaucoup d'inachevé (volontaire) dans ce livre. Les personnages que l'on croise en 1880 ne réapparaissent pas forcément avant que la dernière partie ne se déroule, ou alors seulement en tant que fantôme. Je pense notamment à Delia, cette jeune femme incapable de pleurer une mère qu'elle ne pouvait plus aimer, que l'on revoit seulement un demi siècle plus tard. Les phrases sont souvent inachevées, les personnages ne s'écoutent que rarement parler les uns les autres, de nombreuses scènes sont énigmatiques, et les réponses n'arriveront pas toujours.
Il s'agit en fait pour Virginia Woolf d'équilibrer son roman, de laisser de la place à ce qui est finalement aussi important. La quatrième de couverture a à mon avis raison de dire que le grand meneur de ce texte, c'est le temps. Le temps qui interrompt, qui mène l'histoire et les lecteurs, qui ébranle tout sur son passage, comme le vent que l'on retrouve à de nombreuses reprises. Il fait vieillir les personnages à une vitesse incroyable. Les Pargiter ont à peine le temps de s'interroger sur le sens des choses qu'il ne leur reste déjà plus que des souvenirs, et les lambeaux de leur chair. "Voilà à quoi aboutissent trente ans de vie commune, entre mari et femme - tut-tut-tut et tchou-tchou-tchou. On aurait cru entendre des bestiaux ruminer plus ou moins distinctement dans leur étable - tut-tut-tut et tchou-tchou-tchou - en piétinant la paille douce et fumante de leur litière, de la même manière qu'ils se vautraient jadis dans les marais primitif ; nombreux, prolifiques, à peine conscients, se disait North, tandis qu'il écoutait d'une oreille distraite le jovial clapotement, qui soudain s'adressa à sa personne."
Le texte entier est empreint d'une grande mélancolie, de grands questionnements, portés par une écriture qui n'oublie aucune émotion, mais la fin est étrangement plutôt ouverte et paisible. La dernière partie contient également davantage de descriptions comiques que le reste du roman.
En fait, avec ce texte, pour reprendre des mots de Virginia Woolf picorés dans la préface, l'auteur parvient à combiner "le fait et la vision" à merveille. Il s'agit d'un aboutissement parfaitement réussi pour elle, qui jusque là avait privilégié soit l'un soit l'autre. Cette préface est également très intéressante pour les informations qu'elle contient sur la genèse du texte, et sur les ellipses contenues dans le roman.
"Une rafale soudain s'engouffra dans la rue ; elle chassa un morceau de papier le long du trottoir et un petit tourbillon de poussière sèche lui courut après. Au-dessus des toits s'étendait un de ces couchers de soleil de Londres, rouges et changeants, qui allument dans chaque fenêtre l'une après l'autre, des flambées d'or. Cette soirée de printemps avait quelque chose de sauvage ; même ici à Abercorn Terrace la lumière variait, passait de l'or au noir, du noir à l'or. Delia laissa tomber le rideau ; elle se retourna et vint au milieu du salon en disant tout à coup :
' Oh ! mon Dieu !' "







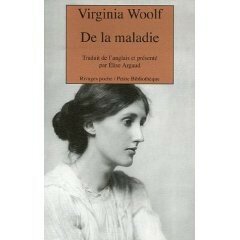
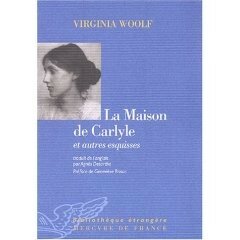
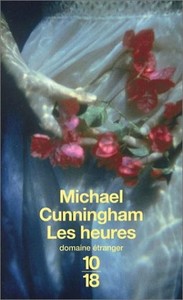
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F5%2F157686.jpg)