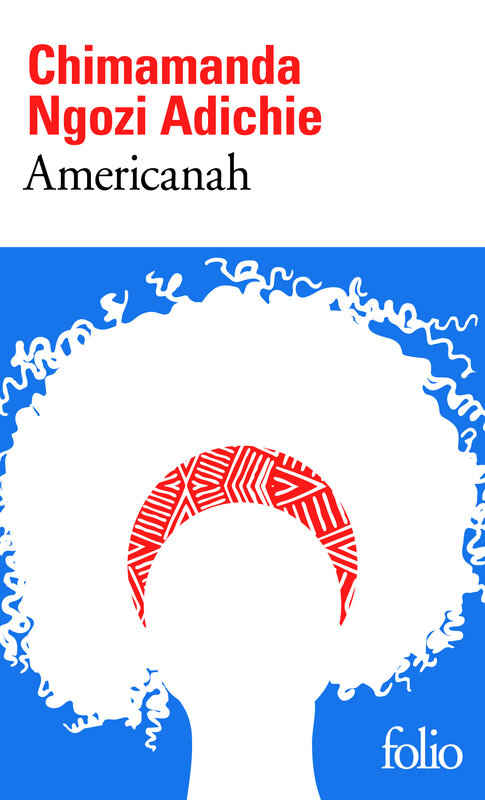 " À mes camarades noirs non américains : En Amérique, tu es noir, chéri
" À mes camarades noirs non américains : En Amérique, tu es noir, chéri
Cher Noir non américain, quand tu fais le choix de venir en Amérique, tu deviens noir. Cesse de discuter. Cesse de dire je suis jamaïcain ou je suis ghanéen. L’Amérique s’en fiche. "
Ifemelu décide, après treize ans en Amérique, de retourner vivre à Lagos. Alors qu'elle se fait coiffer dans un salon afro, elle se remémore son adolescence au Nigéria puis son arrivée aux Etats-Unis, où elle a découvert à quel point la couleur de sa peau comptait.
Devenue blogueuse à succès spécialisée dans les questions de race, elle interpelle les Américains à travers diverses anecdotes afin d'expliquer le quotidien d'une personne noire aux Etats-Unis, pays qui refuse de parler de race, tout en étant encore fondamentalement raciste.
A Lagos, Ifemelu espère retrouver son grand amour, Obinze, qu'elle n'a pas revu depuis son départ et qui a lui aussi été confronté à des difficultés lorsqu'il a voulu s'installer en Angleterre.
Dans un passage du livre, un personnage dit à Ifemelu qu'écrire un livre sur la race qui soit à la fois pertinent et accessible à tous, notamment les Blancs, est impossible. Americanah est la preuve que le défi a été brillamment relevé.
Je ne pense pas que Chimamanda Ngozi Adichie soit un écrivain hors du commun, son style étant très simple, mais elle a définitivement un don pour raconter des histoires d'une grande richesse, très documentées, et qui permettent à n'importe qui de comprendre son propos pourtant complexe. Ainsi, le choix du salon de coiffure spécialisée dans les cheveux crépus qui sert de fil conducteur aux trois-quart du roman n'a rien d'anecdotique. Les cheveux sont l'un des symboles de la différence faite entre les Noirs et les autres. Les cheveux crépus doivent être disciplinés, lissés ou tressés, c'est indispensable pour être pris au sérieux.
Quand elle parla à Ruth de sa prochaine entrevue à Baltimore, celle-ci lui dit : « Mon seul conseil ? Défaites vos tresses et défrisez vos cheveux. Personne n’en parle jamais, mais c’est important. Il faut que vous obteniez ce boulot. »
Un article paru dans le magazine Causette il y a quelques mois expliquait très bien ce phénomène. Les cheveux crépus ne font pas sérieux à tel point qu'ils sont un handicap pour s'insérer dans la société.
Ce point d'entrée capillaire est également accompagné de réflexions sur la ségrégation raciale encore présente aux Etats-Unis, réflexions souvent valables dans les autres sociétés occidentales. Americanah est un livre qui bouscule le lecteur, particulièrement lorsqu'il est blanc. J'ai eu un peu honte de me reconnaître dans certaines descriptions. Le racisme est tellement ancré dans nos sociétés que, même lorsqu'on est de bonne volonté et prêt à se remettre en question, on ne peut s'empêcher d'avoir des attitudes et de tenir des propos qui font légitimement bondir les personnes de couleur. Ifemelu, ainsi qu'Obinze à Londres, évoquent aussi bien les difficultés pour les Noirs de ne pas être vus comme des humains sous-éduqués ou trafiquant de la drogue, que les Blancs essayant de montrer leur tolérance en évoquant la "richesse" des cultures africaines ou leur volonté d'aider les pauvres petits Africains.
« Bonjour, je m’appelle Ifemelu.
— Quel beau nom, dit Kimberly. Est-ce qu’il signifie quelque chose de particulier ? J’adore les noms multiculturels parce qu’ils ont des significations merveilleuses, venant de cultures merveilleusement riches. » Kimberly avait le sourire bienveillant des gens qui voyaient dans la « culture » l’univers inhabituel et coloré des gens de couleur, un mot qui devait toujours être accompagné de « riche ». Elle ne pensait pas que la Norvège ait une « culture riche ».
" Ils ne comprenaient pas que des gens comme lui, qui avaient été bien nourris, n’avaient pas manqué d’eau, mais étaient englués dans l’insatisfaction, conditionnés depuis leur naissance à regarder ailleurs, éternellement convaincus que la vie véritable se déroulait dans cet ailleurs, étaient aujourd’hui prêts à commettre des actes dangereux, des actes illégaux, pour pouvoir partir, bien qu’aucun d’entre eux ne meure de faim, n’ait été violé, ou ne fuie des villages incendiés, simplement avide d’avoir le choix, avide de certitude. "
L'auteur explique à quel point le racisme envers les Noirs est unique, et démontre à quel point dans une situation similaire, un Noir et un non Noir ne seront pas également désavantagés. Le seul point qui m'a gênée concerne les propos de l'auteur sur l'antisémitisme qui ne serait pas aussi humiliant que le racisme envers les Noirs car basé sur de la jalousie. Je pense qu'elle n'a pas, du fait de son expérience au Nigéria et aux Etats-Unis, une vision de ce qu'ont pu vivre les Juifs pendant des siècles en Europe, avec le bouquet final de l'horreur nazi. Les Juifs aussi ont été martyrisés, victimes de ségrégation et de préjugés terribles. Quant à la jalousie censée être une chose plutôt positive, elle a plutôt donné lieu à des faits divers sordides dans nos régions. C'est anecdotique (à peine quelques lignes), et je pense vraiment que Chimamanda Ngozi Adichie est de bonne foi, mais il me semble important de nuancer son propos. A aucun moment l'auteur ne se montre violente, agressive. Elle énonce des faits, adopte un ton railleur mais pas condescendant, et crée les conditions idéales pour que son lecteur l'écoute.
Le retour au pays d'Ifemelu permet à la jeune femme de laisser en grande partie la question de sa couleur de peau derrière elle, mais il n'est pas simple pour autant. Chimamanda Ngozi Adichie n'a pas mâché ses mots à propos de l'Amérique et de l'Angleterre, elle est tout aussi virulente envers le Nigéria et ses habitants. Elle évoque la politique et la corruption dans son pays, est sensible à la place des femmes (elle n'hésite pas à monter au créneau lorsqu'on lui parle des soi-disant sages et soumises Nigériannes), aux questions d'éducation et se moque du comportement des expatriés rentrés comme elles au Nigéria. Notre héroïne s'est parfois sentie très seule aux Etats-Unis, le Nigéria après treize ans d'absence est comme un étranger. Partie à peine sortie de l'adolescence, elle revient adulte.
On lit ce roman avec beaucoup de facilité parce que ses personnages sont très bien croqués. Ifemelu ne peut que plaire si l'on s'intéresse un peu aux questions de société. C'est aussi une personne attachante parce que faillible. Son parcours du combattant aux Etats-Unis nous fait rager et souffrir avec elle. Sa grande histoire d'amour avec Obinze est un peu trop belle, mais ça ne fait pas de mal. Comme dans son précédent roman, L'Autre moitié du soleil, l'auteur évoque surtout des personnages issus des classes moyennes ou aisées, éduqués, parfaitement anglophones, et ses héros sont igbos. Ces éléments ainsi que d'autres indices laissent penser que Chimamanda Ngozi Adichie a mis beaucoup de choses personnelles dans ce livre, et c'est peut-être ce qui lui permet de sonner si vrai.
Un livre passionnant et très facile à lire que je recommande à tout le monde. Difficile de faire un billet qui énumère toutes les pistes qu'il explore tant il y en a.
Les avis d'Ellettres, d'Ys et d'Hélène.
Folio. 684 pages.
Traduit par Anne Damour.
2013 pour l'édition originale.

 Barry Fairbrother, conseiller paroissial à Pagford et père de quatre enfants très apprécié, s'écroule le soir de son dix-neuvième anniversaire de mariage, victime d'une rupture d'anévrisme. Les habitants de la bourgade sont choqués, mais très vite ce sont surtout les prétendants à sa succession qui se manifestent. D'un côté, certains voudraient préserver le travail de Barry en faveur d'un quartier défavorisé et d'une clinique à destination des toxicomanes. De l'autre, les notables locaux, emmenés par Howard Mollison, entendent bien profiter de l'occasion pour se débarasser de ceux qu'ils jugent indignes d'attention.
Barry Fairbrother, conseiller paroissial à Pagford et père de quatre enfants très apprécié, s'écroule le soir de son dix-neuvième anniversaire de mariage, victime d'une rupture d'anévrisme. Les habitants de la bourgade sont choqués, mais très vite ce sont surtout les prétendants à sa succession qui se manifestent. D'un côté, certains voudraient préserver le travail de Barry en faveur d'un quartier défavorisé et d'une clinique à destination des toxicomanes. De l'autre, les notables locaux, emmenés par Howard Mollison, entendent bien profiter de l'occasion pour se débarasser de ceux qu'ils jugent indignes d'attention.





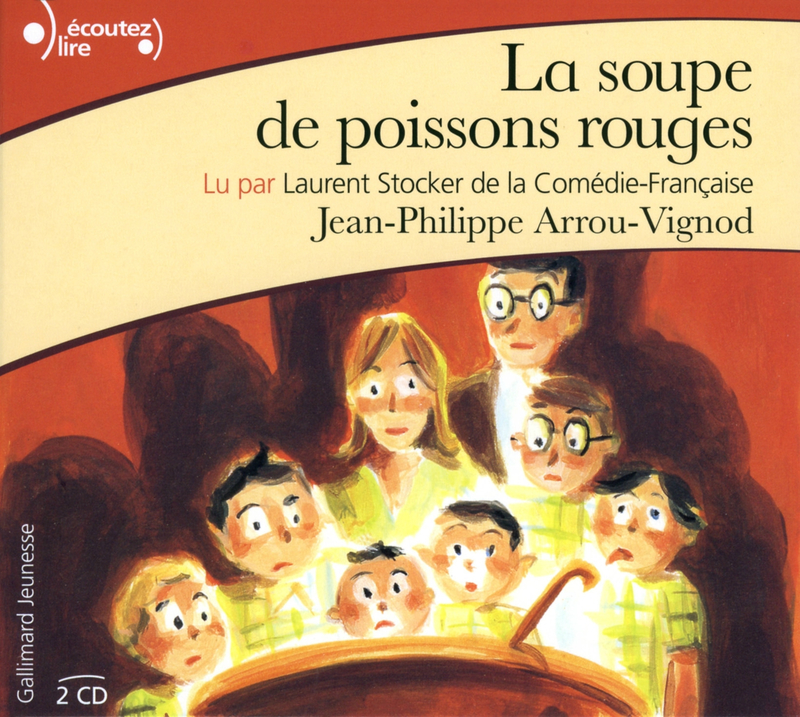



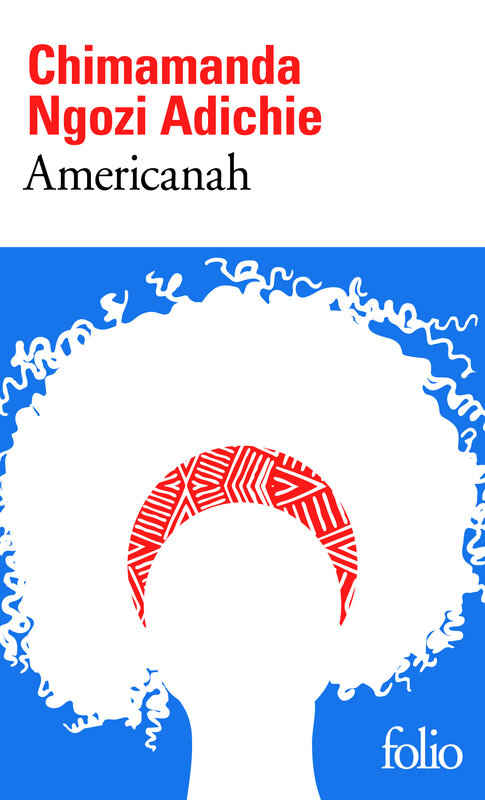





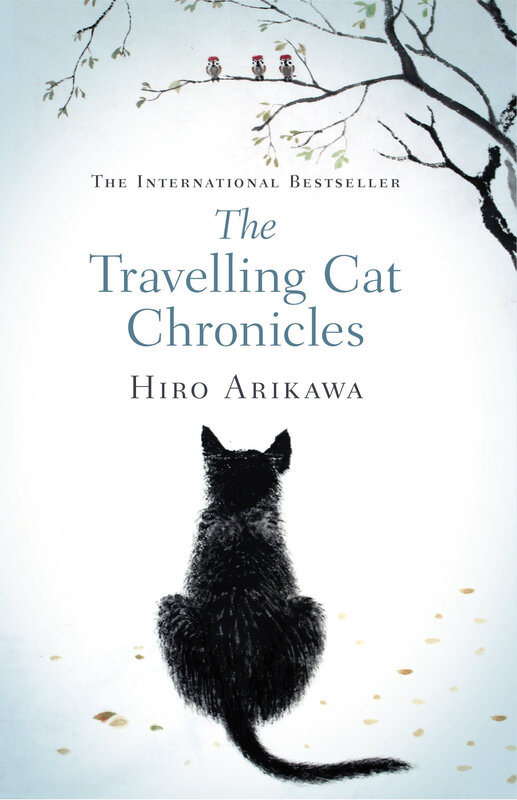
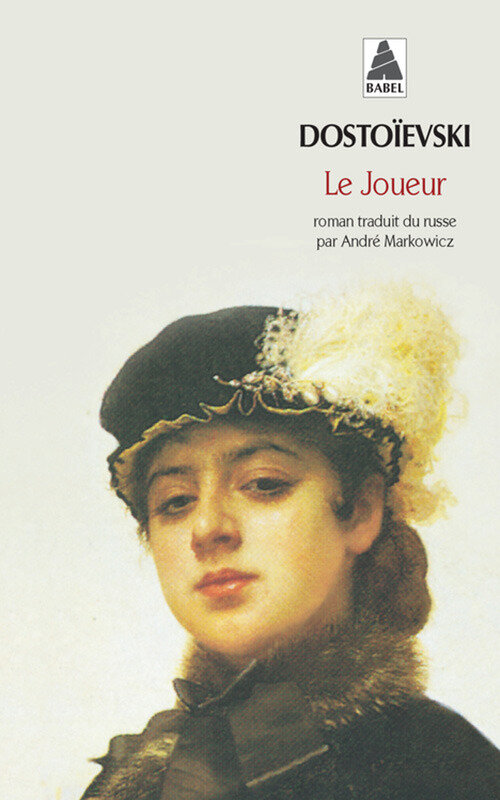
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F5%2F157686.jpg)