L'histoire d'un mariage ; Andrew Sean Greer
 Points ; 263 pages.
Points ; 263 pages.
Traduit par Suzanne V. Mayoux. 2008.
Pearlie Cook prend la parole pour nous raconter sa vie dans les années 1950. Elle vivait alors avec Holland, son mari, et leur fils Sonny. "Les gens se font une idée des années cinquante. Ils parlent des jupes ballon décorées d'un caniche en laisse, des grèves de transports routiers, d'Elvis ; ils parlent d'une jeune nation, d'une nation innocente. Je ne sais pas pourquoi ils se trompent tellement ; ce doit être un dérapage de la mémoire, car tout cela est venu plus tard, à mesure que le pays se transformait. En 1953, rien n'avait changé." Pearlie et Holland se sont connus et aimés durant leur adolescence. La guerre les sépare, mais ils se retrouvent finalement lorsqu'elle s'achève, et se marient. Pearlie se pense alors heureuse, malgré une étrange mise en garde de la part d'une tante de son époux la veille de son mariage, malgré la maladie cardiaque dont souffre son époux, qui l'oblige à censurer son journal, afin que seules les bonnes nouvelles y figurent, et malgré une vie conjugale peu trépidante.
Tout cela vole en éclats lorsque Charles "Buzz" Drumer sonne à la porte des Cook un jour de 1953, forçant ainsi Pearlie à reconsidérer son mariage, son époque, et des souvenirs qu'elle aimerait bien pouvoir effacer.
Je me suis jetée sur ce livre lors de sa sortie en poche, certaine de découvrir un excellent roman, mais je dois reconnaître que je suis finalement mitigée. L'Histoire d'un mariage est construit de façon à faire défiler différentes époques, et à parsemer le récit de révélations censées lui donner un rythme, mais tout cela me semble finalement bien artificiel. Excepté la première information fournie par Buzz, je n'ai pas compris la nécessité de cacher (même si on a quelques indices au début) ce qui est révélé en toutes lettres à la page 72, et le personnage d'Annabel n'avait pas non plus besoin d'être gardé en stock aussi longtemps. De ce fait, ce roman s'étire inutilement en longueur entre le moment où tout bascule et celui où Pearlie sort de sa torpeur et nous permet de la suivre pour une remise à plat des faits.
Je regrette également les nombreux passages où de grandes phrases éculées nous sont balancées comme s'il s'agissait de révéler l'âme humaine et sa profondeur pour la première fois. "Nous croyons connaître ceux que nous aimons." est une jolie expression, mais ce thème n'en est pas moins courant et traité ici de façon conventionnelle en fin de compte. L'histoire d'un mariage est un roman sur les choix, plus ou moins prometteurs de bonheur, qui s'offrent aux personnages dans le contexte des années 1950, sur l'absence de communication, et sur la possibilité de ressusciter des sentiments bridés depuis des années. Il y a aussi tout un pan (considérable) de l'histoire qui demeure inconnu. Pearlie, en femme mariée des années 1950, est seule à se débattre, et n'aura jamais accès aux pensées de son époux, qui est pourtant parfaitement au courant de la situation.
Finalement, ce qui m'a plu dans ce livre, ce ne sont pas tant les relations entre Pearlie, Holland et Buzz, mais l'époque qui transparaît derrière eux. "J'écris une histoire de guerre. Je ne l'avais pas prévu. Au début, c'était une histoire d'amour, l'histoire d'un mariage, mais la guerre s'y est incrustée partout, tel un verre brisé en mille éclats. Non pas une histoire ordinaire de combattants, mais de ceux qui ne partirent pas à la guerre. Les lâches et les planqués..." (pour ceux qui craignent les spoilers, sachez que c'est en réalité bien plus compliqué). Le procès des époux Rosenberg, le maccarthysme, la guerre de Corée, le racisme, l'homophobie, le puritanisme hypocrite transparaissent dans ce récit, comme des échos à la vie conjugale et au passé de Pearlie. Le quartier tranquille où vivent les Cook a beau condamner tout ce qui sort de l'ordinaire, le goût prononcé des habitants pour les histoires sanglantes et le zèle dont certains habitants font preuve, font rire jaune.
Il ne s'agit pas d'un roman abominable. Il se lit avec beaucoup de facilité, mais il fait preuve de trop de maladresse et cède trop facilement à certains clichés pour sortir du lot.
Les avis d'Amanda, Clarabel, Cuné, Titine, Manu et Papillon.





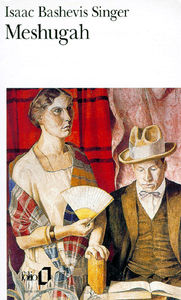


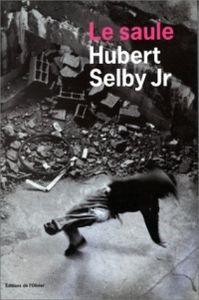


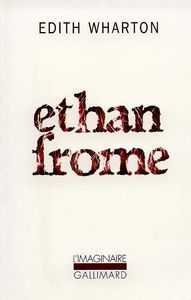




/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F5%2F157686.jpg)